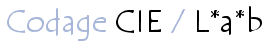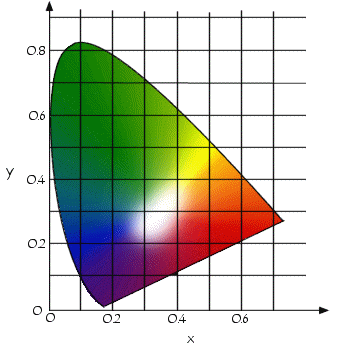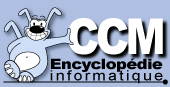
|
|
|
Les couleurs peuvent être perçues différemment selon les individus et peuvent être affichées différemment selon les périphériques d'affichage. La Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) a donc défini des standards permettant de définir une couleur indépendamment des périphériques utilisés. A cette fin, la CIE a défini des critères basés sur la perception de la couleur par l'oeil humain, grâce à un triple stimulus. En 1931, la CIE a élaboré le système colorimétrique xyY représentant les couleurs selon leur chromaticité (axes x et y) et leur luminance (axe Y). Le diagramme de chromaticité (ou diagramme chromatique), issu d'une transformation mathématique représente sur la périphérie les couleurs pures, c'est-à-dire les rayonnements monochromatiques correspondant aux couleurs du spectre (couleurs de l'arc en ciel), repérées par leur longueur d'onde. La ligne fermant le diagramme (donc fermant les deux extrémités du spectre visible) se nomme la droite des pourpres, car elle correspond à la couleur pourpre, composée des deux rayonnements monochromatiques bleu (420 nm) et rouge (680 nm) :
On représente généralement le gamut d'un dispositif d'affichage en traçant dans le diagramme chromatique un polygone renfermant toutes les couleurs qu'il est capable de produire. Toutefois, ce mode de représentation purement mathématique ne tient pas compte des facteurs physiologiques de perception de la couleur par l'oeil humain, ce qui résulte en un diagramme de chromaticité laissant par exemple une place beaucoup trop large aux couleurs vertes. En 1960 la CIE mit au point le modèle Lu*v*. Enfin en 1976, afin de remédier aux lacunes du modèle xyY, la CIE développe le modèle colorimétrique La*b* (aussi connu sous le nom de CIELab), dans lequel une couleur est repérée par trois valeurs :
Le mode Lab couvre ainsi l'intégralité du spectre visible par l'oeil humain et le représente de manière uniforme. Il permet donc de décrire l'ensemble des couleurs visibles indépendamment de toute technologie graphique. De cette façon il comprend la totalité des couleurs RGB et CMYK, c'est la raison pour laquelle des logiciels tels que PhotoShop utilisent ce mode pour passer d'un modèle de représentation à un autre. Il s'agit d'un mode très utilisé dans l'industrie, mais peu retenu dans la plupart des logiciels étant donné qu'il est difficile à manipuler. Les modèles de la CIE ne sont pas intuitifs, toutefois le fait de les utiliser garantit qu'une couleur créée selon ces modèles sera vue de la même façon par tous ! | |||||
|
Ce document intitulé « Vidéo et imagerie numérique - Le codage CIE / Lab (L*a*b) » issu de Comment Ça Marche est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement. |